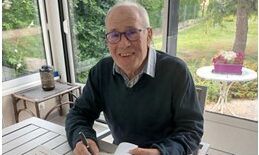Après l’hiver, reviendra le printemps…
© Jean-Pierre Barré – novembre 2024
Roman
Prologue
« Coucou, c’est moi ! » lança Patrick en refermant la porte de l’appartement. Il employait cette phrase à chaque arrivée. C’était toujours la même qu’il utilisait depuis ses années d’école primaire. Cinquante ans plus tard, elle continuait à le faire rire.
Depuis un an, il était à la retraite. Chaque soir, il rendait visite à sa mère pour s’assurer qu’elle allait bien. À 90 ans, Catherine démontrait une vitalité remarquable, incarnant parfaitement la maxime « bon pied, bon œil ». Cependant, ces derniers temps, elle se déplaçait plus lentement et avec prudence. Elle recevait le concours d’une aide-ménagère pour son ménage et ses repas, tandis que sa fille Chantal s’occupait des courses principales.
Les cheveux de la vieille dame, fins et légèrement gris, étaient toujours soigneusement coiffés. Ses yeux, entourés de légères rides, semblaient témoigner de l’histoire d’une vie qu’elle avait gardée secrète.
Catherine entretenait un lien fort avec ses deux enfants. Une relation profonde, empreinte d’affection et de compréhension mutuelle. Elle se reflétait dans chaque sourire échangé, chaque moment de soutien et chaque épreuve surmontée ensemble.
Patrick retrouva sa mère dans son petit salon, éclairé par une douce lumière. Le décor était resté pratiquement le même depuis ses plus lointains souvenirs. Les meubles, les cadres avec les photos de famille accrochés aux murs, le tapis usé et surtout ce fauteuil étaient demeurés en place.
Un court répit s’installa avant qu’ils n’entament une conversation sur des sujets banals. Les pensées de Catherine étaient ailleurs. L’après-midi, elle avait revécu des moments de son passé, des joies et des peines.
Après avoir embrassé sa mère, Patrick fut le premier à mettre fin au silence :
– Alors, après-demain c’est le grand jour. Tu te sens prête ?
– J’y pense depuis ce matin, avoua Catherine.
La vieille dame s’apprêtait à célébrer son anniversaire. Ses enfants, petits-enfants et même son arrière-petite-fille seraient tous présents pour ce dimanche de printemps 2018. Cet évènement constituait une occasion unique pour toute la famille de se réunir, de se remémorer des souvenirs, de rire. Catherine attendait avec impatience le moment de revoir ces visages familiers, qui lui rappelleraient son passé, ses joies et ses peines, ses espoirs et ses rêves.
Patrick lui assura que cette journée serait merveilleuse.
— Tous tes amis et tes proches viendront te dire combien ils t’aiment et te remercier !
— Pas tous ! répliqua Catherine, le regard empreint d’une tristesse perceptible. Deux personnes en particulier me manqueront terriblement. Surtout, ton père, avec qui j’ai passé les plus belles années de mon existence…
Patrick n’ignorait pas à quel point sa mère l’avait profondément chéri. Elle avait l’habitude de répéter qu’à sa première rencontre avec lui, elle avait su qu’il serait l’homme de sa vie. Comment aurait‑elle pu résister à son sourire enjôleur ? André avait été un papa aimant et attentif pour ses deux enfants, leur offrant une protection et une écoute constantes. Deux ans auparavant, il avait paisiblement quitté ce monde.
… Catherine poursuivit :
— Et puis, ma sœur adoptive, Sylvie, qui ne viendra pas d’Angleterre, où elle habite toujours. Ses difficultés de mobilité se sont aggravées ces derniers temps. Il est vrai qu’elle n’est plus toute jeune !
— Elle a ton âge, maman ! s’amusa Patrick.
Catherine esquissa un petit sourire, tandis que son fils ajoutait :
— D’ailleurs, demain, je ne pourrai pas passer. Le matin, je dois aller à la mairie pour récupérer les clés de la salle. Puis, on doit procéder à l’installation et à la décoration…
— Je vous donne du travail, l’interrompit Catherine. Tu ne fais pas cela tout seul ?
— Non, j’ai de l’aide. Et dimanche en fin de matinée, Nicolas viendra te chercher pour te conduire à la fête. Ton petit‑fils s’enthousiasme pour cela.
— Il est adorable, tout comme les autres.
Patrick eut du mal à dissimuler quelques signes d’affliction :
— Connaître sa grand-mère est une source inestimable de bonheur. Je n’ai pas eu cette chance…
Catherine s’efforçait de trouver une réponse. Ses enfants n’avaient jamais posé beaucoup de questions sur leurs grands-parents. Elle savait que Patrick et sa sœur éprouvaient de la curiosité à ce sujet. Finalement, Patrick osa aborder le sujet :
— Tu ne m’as jamais beaucoup parlé de tes parents, remarqua-t-il.
Catherine sentit une pointe de reproche.
— En fait, je ne les ai pas très bien connus.
Un moment, Patrick eut le sentiment que sa mère pourrait enfin lui confier quelques détails sur leur passé. Il se leva, tira une chaise vers le fauteuil de sa mère, s’y installa, puis dit :
— Si tu veux, nous avons encore un peu de temps avant le repas.
Catherine avait toujours refusé de raconter l’histoire de sa vie. Sa jeunesse était parsemée d’épreuves et de défis qui avaient façonné son caractère et son destin.
Après quelques instants de réflexion, elle tourna la tête vers son fils :
— Je te promets qu’un jour je te raconterai.
Soudain, une expression troublée apparut dans les yeux de sa mère, ce qui amena Patrick à ne pas insister. Il se leva et l’embrassa affectueusement en l’enlaçant étroitement :
— Bon, je dois y aller. À dimanche !
— Oui, murmura-t-elle, laissant transparaître un sentiment de regret.
Dès que la porte d’entrée se fut refermée, les souvenirs refirent surface.
À l’époque, elle avait 8 ans…
Chapitre 1.
Malgré la crise sociale qui agitait le pays depuis le début du mois, la vie semblait continuer comme si de rien n’était dans cette grande ville du centre de la France. Au cœur du quartier des halles, où se mêlaient les odeurs de viande, de poisson et de fruits, un immeuble vétuste abritait au premier étage un appartement aux allures de taudis. Ce mardi 12 mai, dans une chambre aux murs décrépis où trônait un lit aux draps usés, Monique souffrait depuis plusieurs mois d’une maladie qui la rongeait de l’intérieur.
Denise, sa sœur de dix ans son aînée, travaillait comme soignante à l’hôpital du centre‑ville. Contrainte de s’occuper d’elle, elle semblait constamment de mauvaise humeur. Habituée aux situations critiques, elle lui prodiguait les soins nécessaires avec la froideur de ceux qui ont l’habitude de côtoyer la souffrance.
Monique et Denise possédaient des personnalités, des valeurs et surtout des intérêts très différents, ce qui avait toujours rendu leur relation difficile et conflictuelle. Elles n’avaient jamais partagé les mêmes passions ni les mêmes rêves. Elles s’étaient souvent disputées, parfois pour des broutilles, sans jamais se mettre à la place de l’autre. Elles ne savaient pas comment communiquer efficacement ni comment exprimer leurs besoins et leurs émotions. Elles étaient si dissemblables, si incapables de se comprendre.
Denise avait épousé Roger en 1915. Celui‑ci avait été blessé lors des premiers mois de la Grande Guerre. Il avait perdu trois doigts dans une explosion d’obus. Réformé, il avait rejoint le logement de sa famille, mutilé et traumatisé, sans espoir de retrouver une vie normale. Il se sentait inutile et rejeté par la société. Il passait ses journées à se morfondre chez ses parents, à relire les lettres de ses camarades tombés au front. Après la terrible épreuve de la Grande Guerre, sa rencontre avec Denise l’avait transformé. Grâce à elle, il avait été affecté comme brancardier à l’hôpital général de la ville. Le conflit armé terminé, il avait été confirmé à ce poste qu’il occupait désormais, à mi‑temps.
Jean Robin, le mari de Monique, avait choisi de rejoindre la marine nationale à dix-huit ans. Il avait cherché ainsi à échapper à des parents qui l’avaient négligé pendant ses premières années. Il espérait trouver dans l’armée une nouvelle famille, plus solidaire et plus respectueuse.
Il n’avait plus rien qui le rattachait à son enfance, sauf les moments heureux passés avec Jules, son cousin, dans la grande ferme des parents de celui‑ci. Il se souvenait avec nostalgie de ces étés insouciants et joyeux. C’était au cours de l’un d’eux qu’il avait rencontré Monique. Lors d’une permission en 1925, il avait fait la connaissance de celle qui était alors la petite amie de Jules. Elle lui avait plu aussitôt, mais la jeune fille n’était pas libre. Il avait respecté son choix, tout en gardant l’espoir de la revoir un jour. Quand il avait appris par hasard que Jules avait mis fin à leur fréquentation, il n’avait pas perdu de temps. Il lui avait écrit une longue lettre, où il lui exprimait ses sentiments, et lui avait demandé de lui donner une chance. Il lui avait avoué qu’il l’aimait depuis leur première rencontre et qu’il se sentait prêt à tout pour la rendre heureuse.
La relation entre Jules et Monique n’avait pas été du goût des parents du jeune homme. Appartenant à une classe sociale plus élevée, ils lui avaient ordonné de mettre fin à ce qu’ils considéraient comme une liaison sans lendemain, arguant que la jeune fille n’était pas digne de lui ni de sa famille. Jules l’avait annoncé à Monique, tout en l’assurant de son amour. Elle avait eu du mal à accepter sa décision, mais n’avait pas tardé à se consoler avec les vibrantes déclarations que Jean lui adressait par courrier. Elle y était très sensible et n’avait guère attendu pour lui répondre. Leurs échanges épistolaires étaient alors devenus de plus en plus nombreux. Si bien que Jean passait désormais ses permissions auprès de sa belle. À l’occasion de l’une de celles‑ci, il avait rendu visite à son cousin, mais n’avait pas été accueilli avec la même chaleur. Il était évident que Jules n’avait pas oublié Monique. Il nourrissait secrètement l’espoir de la reconquérir un jour. Il ne supportait pas de la voir avec un autre homme. Il se sentait jaloux et frustré. Il les avait observés en cachette. Un sourire avait alors crispé ses lèvres. Elle riait avec lui. Un autre. La jalousie rongeait Jules. Il serrait les poings. Un jour, il la récupérerait. Il essayait de cacher ses sentiments, mais ils transparaissaient dans son regard et son attitude.
La relation amoureuse entre Monique et Jean s’était confirmée au fil des mois. Ils étaient heureux ensemble et avaient envisagé de construire un avenir à deux. Ils s’étaient mariés en 1927.
Ce jour-là, Denise achevait tranquillement son repas frugal en parcourant la presse locale, sans se laisser troubler par les soupirs étouffés qui sortaient de temps en temps de la bouche de la mourante. Elle avait l’habitude de ces scènes pénibles qui se répétaient sans qu’aucun médecin ne puisse soulager la souffrance de sa sœur. Denise se disait qu’il valait mieux pour Monique que tout finisse bientôt. Elle pourrait enfin reprendre sa vie normale, sans devoir s’occuper d’une malade qu’elle jugeait ingrate.
Elle tournait les pages du journal avec indifférence, jetant un œil distrait aux nouvelles locales, aux faits divers, aux annonces publicitaires. Rien ne l’intéressait vraiment, sauf le résultat de la Loterie nationale française créée trois ans plus tôt. Peut‑être qu’un jour elle gagnerait le gros lot !
Dans un recoin sombre de la chambre où Monique agonisait, Catherine, une enfant de huit ans, s’amusait avec une poupée de chiffon. Un jouet usé et déchiré qui était son précieux trésor. La fillette riait de voir parfois sa mère grimacer lorsqu’elle le lui mettait sous le nez. Par moments, la petite se faufilait en silence vers son lit. Elle cherchait sur ses traits un signe de vie. Mais elle n’apercevait qu’un visage immobile, blême, les yeux fermés, avec ce râle qui la hantait depuis longtemps. Alors, elle repartait à son jeu.
Monique avait dû s’installer chez Denise après avoir quitté son appartement du centre‑ville. Elle était trop mal en point pour s’occuper seule de sa fille. Denise avait été prévenue par des voisins inquiets et avait accepté d’accueillir pour un temps sa sœur et sa nièce. Jean, le mari de Monique, était un militaire de carrière. Il servait sur un navire de guerre basé à Brest. Il affirmait avoir demandé à être rapatrié dès lors que sa femme avait été souffrante… sans succès.
Denise avait dû adapter ses horaires de travail à l’hôpital. Elle avait choisi le service de nuit. Le matin, à son retour, elle se reposait seulement quelques heures. Roger, travaillant l’après-midi, restait à la maison pour veiller sur la malade. Par solidarité, une voisine venait s’occuper de la fillette avant son départ pour l’école.
Monique souffrait d’une maladie mystérieuse. Les premiers symptômes s’étaient déclarés il y avait maintenant une année. Elle avait été admise à l’hôpital pour une crise d’appendicite, mais les médecins avaient découvert que son problème était ailleurs. Ils avaient exploré son abdomen sans trouver la cause de ses maux. Après l’opération, le chirurgien avait pris Denise à part pour lui parler de sa sœur. « Je suis désolé, mais il n’y a plus d’espoir », lui avait-il annoncé sans ménagement. Son ventre était rempli de tumeurs malignes et inaccessibles. « Aucune intervention ni aucun traitement ne peuvent la guérir. Il faut se préparer au pire », avait-il ajouté sans émotion.
Monique était rentrée chez elle avec ce diagnostic pessimiste et des médicaments pour soulager la douleur.
Depuis, le sombre pronostic se confirmait. Les médecins désespéraient de sauver Monique. L’heure fatale approchait. Il y avait trois jours qu’elle demeurait le plus souvent sans conscience. À peine, de temps à autre, pouvait-on croire à un instant de lucidité, lorsqu’elle arrêtait ses yeux déjà vitreux sur Catherine.
Heureusement pour elle, ces instants devenaient rares, car, dans son regard, on sentait une angoisse telle, que l’on était tenté de louer la perte de connaissance qui venait mettre fin à ce supplice.
La malade était torturée par l’idée de se séparer de sa chère petite Catherine. Elle redoutait de la laisser seule, loin de son père, au milieu d’une famille qui était toujours restée étrangère.
Lorsque Monique était terrassée par la douleur, personne ne s’apercevait du combat terrible qu’elle livrait.
Catherine, quant à elle, ne quittait pas le chevet du lit. Elle lui tenait la main, lui parlait doucement, lui souriait avec tendresse. Malgré les paroles sombres des docteurs qu’elle n’avait pas toutes comprises, elle espérait encore un miracle.
À vingt heures précises, le carillon de la vieille horloge surplombant la porte d’entrée se fit entendre. Denise posa sa fourchette et essuya ses lèvres avec sa serviette. Elle était seule à table, comme presque tous les soirs. Roger finissait son travail à dix-huit heures, mais ne rentrait jamais avant vingt et une heures. Elle ne lui demandait en aucun cas la moindre explication qu’il n’aurait d’ailleurs pas fournie.
Elle se leva et partit rejoindre sa sœur dans la chambre. Catherine était assise sagement au pied du lit, les mains croisées sur ses genoux.
— Il est tard, lui dit-elle d’un ton sec. Va te coucher tout de suite.
La petite hocha la tête, les larmes lui vinrent aux yeux, elle sanglota :
— Mais je veux rester auprès de maman.
— Elle n’a pas envie que tu sois à ses côtés. Tu n’es qu’une source d’ennuis. Obéis-moi !
— S’il te plaît, laisse-moi un peu plus longtemps avec elle.
— C’est inutile. Elle est inconsciente. Si elle se réveille, je te préviendrai.
Catherine réprima mal un soupir de résignation et ravala ses pleurs. Elle connaissait sa tante et savait bien qu’il n’en serait rien. Suivie par Denise qui la poussait dans le dos, elle prit sa poupée de chiffon et s’en alla après un dernier regard vers le lit.
Arrivée dans le débarras qui lui servait de pièce pour dormir, elle commença à déboutonner sa blouse.
— Dépêche‑toi un peu, pesta Denise en tirant sans ménagement une manche du tablier d’un geste brusque.
— Tu me fais mal ! s’écria Catherine, dont les larmes, contenues depuis un moment, roulèrent sur ses joues. Maman était plus douce quand elle me déshabillait !
Cette réflexion eut le don d’agacer sa tante.
— Écoute, ta mère c’est ta mère ! Elle agissait comme elle voulait. Moi, je fais ce que je peux, répliqua Denise. J’ai déjà assez de travail avec vous deux ! Je passe mes journées à soigner une malade, en plus je dois m’occuper de toi ! Si tu n’es pas contente, déshabille‑toi toute seule !
Denise lui tourna le dos, abandonnant la fillette stupéfaite par tant de méchanceté. Elle se dirigea vers la chambre pour donner les médicaments à sa sœur. Sans bruit, Catherine la suivit.
En approchant du lit, Denise éprouva une sensation de malaise. Monique, les yeux écarquillés, la dévisageait avec sévérité. Elle essayait visiblement de lui parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Son regard inquiet passait de sa fille à elle, comme si elle avait saisi le sens de leurs dernières paroles.
Enfin, après un effort violent, elle put articuler le nom de Catherine. Celle‑ci l’entendit et se précipita vers sa mère, montant sur une chaise pour lui faire un bisou sur le front.
Surprise, Denise ne sut quelle attitude adopter. De sa main, Monique fit signe à Catherine de se rapprocher. La fillette s’exécuta et se mit à chuchoter à l’oreille de sa maman :
— Comment ça va, tu as encore mal ? Quand je suis partie, tu dormais, je n’ai pas pu te dire au revoir. J’ai fait tout doucement pour ne pas te réveiller. Demain, tu pourras peut-être sortir du lit ?
La malade secoua tristement la tête.
— Je ne pense pas, murmura-t-elle avec peine.
— Jamais plus ! s’exclama l’enfant.
— Non, c’est fini, je ne me lèverai plus… jamais ! Je vais m’endormir… pour longtemps, parce que je suis épuisée et toi, tu continueras à être sage et gentille avec tata Denise.
Monique semblait retrouver un peu d’énergie pour donner ses derniers conseils à la fillette. Elle tourna un regard implorant vers Denise en ajoutant faiblement :
— Occupe-toi bien d’elle.
Sa sœur resta silencieuse.
— Maman, qu’est‑ce que je vais devenir si tu dors tout le temps ? glissa Catherine dans le creux de l’oreille de sa mère.
— Tu rejoindras ton papa et tu lui apprendras que je me suis endormie en pensant à lui. Tu te montreras également très gentille avec lui pour le consoler.
— Il aura de la peine lui aussi ?
— Oui, puisqu’il ne me verra plus, car je vais fermer les yeux pour toujours.
Catherine ne démordait pas de son idée.
— Pourtant, tu viendras avec nous ? On te soignera. Moi, je ne veux pas te quitter !
— Non, là où je serai, je n’aurai plus besoin de soins.
Elle haletait. Les paroles ne sortaient qu’une à une avec effort de ses lèvres tremblantes. Catherine poursuivit ses questions :
— Tu reviendras me voir, hein ? Tu m’adresseras un signe ?
— Oui, ma chérie, mais n’oublie jamais : je t’aime et je serai toujours avec toi dans ton cœur.
Petit à petit, le ton s’était affaibli, pour ne plus devenir qu’un souffle. Puis, de nouveau, sa bouche s’agita sans qu’on ne pût rien comprendre. Son regard se troubla, ses paupières tombèrent lourdement.
Les mains de la moribonde cherchèrent autour d’elle et rencontrèrent la tête de Catherine penchée sur son visage. Elle caressa les cheveux de sa fille et lui sourit faiblement, puis elle cessa de respirer.
Denise s’approcha du lit et vérifia le pouls de sa sœur. Elle s’en était allée, alors elle lui croisa les doigts. Elle prit Catherine dans ses bras, la serra contre elle avant de la poser par terre.
— Viens, ma petite, il faut que ta maman se repose. Elle est partie en paix. Elle est heureuse maintenant.
D’une voix tremblante, Catherine voulut savoir avec une naïveté touchante :
— Elle n’est plus vivante ?
— Non, elle est morte. Mais elle est toujours présente dans nos souvenirs. Je dois prévenir le médecin et le curé pour qu’ils s’occupent d’elle.
Elle essuya les larmes de la petite.
Elle s’apprêtait à emmener Catherine hors de la pièce lorsque la porte d’entrée de l’appartement s’ouvrit pour permettre le passage de Roger. C’était un grand homme maigre, vêtu d’un costume sombre et d’un chapeau mou. Il tenait à la main une sacoche en cuir usée qu’il posa sur le sol avec un soupir. Le visage fermé, mal rasé, il était rare qu’il rentre avant la nuit, mais, ce soir, il avait dû sentir que quelque chose n’allait pas. Il regarda autour de lui, cherchant des signes de vie dans le salon aux murs défraîchis. Il n’y avait personne. Il se dirigea vers la cuisine, espérant trouver quelque chose pour assouvir sa faim. Il ouvrit le garde‑manger et vit quelques restes du repas de midi. Sur la table, un pot de confiture et un morceau de gros pain avaient été posés à son intention. Il s’en coupa une tranche, s’assit et commença à manger.
Denise l’avait entendu rentrer. Tenant Catherine par la main, elle vint le rejoindre. Il ne prit pas la peine de relever la tête. Sans se formaliser, d’un ton las, Denise lui annonça en désignant du menton la chambre où se trouvait le corps sans vie de sa sœur :
— C’est terminé, la pauvre ne souffre plus.
Roger daigna enfin regarder sa femme.
— Il ne manquait plus que ça ! lança‑t‑il d’une voix éraillée. Qu’allons-nous faire maintenant ?
— Je ne sais pas, avoua Denise. Il faut prévenir le père de la petite.
— Tu parles, il doit encore être en mer !
— Alors, c’est nous qui prendrons la décision pour les funérailles.
— En attendant, qu’est‑ce que tu vas faire de la gamine ?
— Je l’emmène dans son lit et toi tu files chez le médecin. On verra pour un prêtre demain matin.
— Ça, c’est ton problème. Moi, je ne veux pas avoir affaire au curé !
Denise n’avait pas la force de discuter avec son mari. Elle se contenta de prendre Catherine par la main et de la conduire jusqu’à sa chambre à coucher. La petite se mit en chemise de nuit toute seule et se glissa sous son drap. Elle se souvenait des derniers mots de sa mère : « Je vais dormir… pour toujours ! » Qu’est-ce que ça voulait dire, ce sommeil ? Catherine ne comprenait pas bien ce que cela impliquait. Ces mots lui semblaient vides de sens. Mais elle se doutait qu’ils étaient graves et elle se sentait de plus en plus malheureuse. Elle serra sa poupée contre son visage et se mit à pleurer doucement.
Elle n’arrivait pas à s’endormir. À côté, où sa mère gisait, elle entendait du bruit. Que se passait‑il dans cette pièce où le silence aurait dû régner ? Sa maman ne pouvait-elle pas dormir tranquillement ? Catherine ignorait que son oncle et sa tante profitaient de son absence pour fouiller dans les affaires de sa mère décédée. Que cherchaient‑ils ? Des objets de valeur, des documents compromettants, sans respect pour la mémoire de la défunte. Catherine aurait été horrifiée si elle avait su ce qu’ils faisaient derrière son dos.
Chapitre 2.
Lorsque le lendemain, Jean, bénéficiant d’une permission exceptionnelle, arriva en fin de journée chez son beau‑frère et sa belle‑sœur, les retrouvailles familiales ne furent guère chaleureuses. Il lui fallut peu de temps pour s’apercevoir qu’il n’était pas le bienvenu dans cette demeure où tout semblait figé et oppressant. La relation avec Roger et Denise n’avait jamais été très bonne. Il se sentait seul et mélancolique, sans personne à qui se confier. Il ne voyait pas comment il pourrait un jour s’adapter à cette vie morne et monotone.
Le lendemain, pendant une majeure partie de la journée, Jean fut occupé à la préparation des formalités liées aux funérailles. Ces moments passés à l’extérieur le protégeaient des discussions houleuses.
Tous les trois se retrouvèrent pour le dîner, dans une atmosphère lourde. Les convives évitèrent de se regarder, de peur de déclencher une inutile dispute. Le silence était seulement interrompu par le bruit des couverts et des verres. Personne ne semblait apprécier le repas ni la compagnie. Chacun attendait que le moment soit passé, sans oser prendre congé. Ce fut un dîner raté, confirmant les tensions et les rancœurs entre les participants.
Pour rendre hommage à Monique, Jean avait décidé…