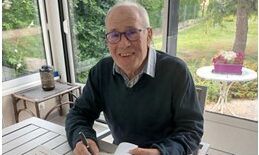À vingt‑cinq kilomètres de la grande ville, Neuillé‑sur‑Racan, commune rurale de Touraine, compte à peine un millier d’habitants. La mairie occupe le centre de l’unique place du village. Sur l’un de ses côtés, deux grands bâtiments abritent les écoles primaires, sur l’autre, s’élèvent l’église et son presbytère.
En face, les boutiques jouxtent les rares habitations. Les indispensables commerces alimentaires, boucherie, boulangerie, épicerie côtoient le non moins irremplaçable café du bourg. Jumelé à un salon de coiffure pour hommes, il constitue le lieu de rencontres et de discussions de ces messieurs. Les dames, quant à elles, réservent leurs bavardages à la grande quincaillerie-bazar dans lequel elles ont l’assurance de trouver tout ce dont elles ont besoin. Le trottoir devant le magasin est encombré d’arrosoirs, de grillages, de matériel de jardinage quand ce ne sont pas, au début de l’été, des piles de bocaux destinés aux conserves.
Jeanne naît en juillet 1873, dans une fermette un peu à l’écart du village, en pleine saison des moissons. Son père, ainsi privé de sa femme durant cette période cruciale, enrage. Il estime que sa présence est indispensable aux travaux des champs. Dure à la peine, la jeune maman parle peu et se plaint encore moins. En se mariant, elle a trouvé un homme, certes courageux, mais ivrogne et brutal. Ses journées sont bien remplies. Après la traite des trois vaches, ses habituelles tâches ménagères l’attendent. Elle se rend ensuite dans le bois voisin effeuiller les arbres pour nourrir les chèvres, ramasser les glands pour les deux cochons. Sa besogne accomplie, elle doit encore aider aux travaux de la terre. Le courage ne lui fait pas défaut, mais sa soumission muette, tacite, guide sa manière de se comporter.
Pourtant, cette fois‑ci, avec la venue de Jeanne, la jeune mère reste alitée près de quarante-huit heures. Cela n’est pas du goût de son mari, également contrarié par le sexe du nouveau-né : une fille. Il ne se gêne pas pour le faire savoir à sa femme. L’année précédente, un garçon avait vu le jour, mais n’avait survécu que quelques semaines. Il ne fêtera pas la naissance d’une fille, tout juste prendra‑t‑il quelques chopines de plus au café du village.
Dès son plus jeune âge, Jeanne est formée aux rudes principes paternels. Au prix de discussions véhémentes avec son mari, sa mère réussit malgré tout à envoyer la fillette, de la Toussaint à la Saint Médard, à la petite école du village pour y apprendre à lire et à compter, même si son père ne se prive pas de beugler que « ça ne sert à rien, surtout pour une fille ». Par contre, malgré l’insistance de sa mère, bien que baptisée, Jeanne n’ira pas au catéchisme. Elle enviera ses camarades de classe qui revêtiront, un dernier dimanche de mai, leurs belles robes de communiantes, devenant, à cette occasion, les princesses d’un jour. Elles recevront de nombreux cadeaux qu’elles s’empresseront d’énumérer pendant la récréation.
Ce jour-là, Jeanne réussit à fausser compagnie à son père. Elle s’est rendue à l’église de Neuillé qui est en fête. Restée à l’extérieur, elle observe la trentaine de garçons et de filles qui célèbrent leur communion solennelle. Parmi tous ces jeunes, Jeanne n’a d’yeux que pour Hector Meunier. Pourtant, celui‑ci ne lui a adressé la parole qu’à de rares occasions. Elle l’admire dans son beau costume, acheté pour la circonstance, orné au bras gauche du traditionnel brassard blanchâtre. Hector domine, à peu de choses près, tout le monde d’une tête, il a fière allure dans son habit. Les premières communiantes ne sont pas les dernières à dévisager d’un œil attendri ce charmant jeune homme.
C’est le cœur lourd qu’elle rentre chez elle.
La modeste exploitation permet à la famille de subsister tant bien que mal. Alors il ne reste aux parents qu’une seule issue : travailler et travailler encore. Pas de place pour des manifestations de tendresse, le couple ne témoigne à Jeanne que froideur, voire indifférence.
À douze ans, malgré la démarche de la directrice de l’école pour infléchir la décision de son père, la petite quitte l’école après avoir écouté la maîtresse commenter abondamment les funérailles nationales de Victor Hugo. Désormais elle va s’échiner dans la ferme où le père règne en maître. C’est lui qui décide du travail de sa femme et de sa fille. La plupart du temps, Jeanne seconde sa mère, mais quelquefois son père l’oblige à partager sa propre besogne. Les tâches sont souvent pénibles, cependant la fillette a appris à ne jamais se plaindre. Entre une mère qui subit sans rien dire et un père qui leur aboie dessus à tout bout de champ, la jeune fille vit une adolescence difficile. Les scènes de violence lui resteront longtemps en mémoire.
Il lui faut attendre ses dix-huit ans pour que son paternel l’autorise enfin à s’absenter quelques heures après le déjeuner dominical, posant comme condition expresse qu’elle soit revenue pour la traite du soir. Avec son amie, employée dans une ferme voisine, elle aime aller au bal. Comme elle ne manque pas de charme, les cavaliers sont nombreux à la solliciter. Jeanne n’accepte que très rarement les invitations. Elle préfère danser avec sa camarade. Être dans les bras d’un homme la dérange, d’autant qu’ils ont souvent tendance, au fur et à mesure de la danse, à la serrer de plus en plus. Si encore le beau Victor Meunier l’invitait ! Mais elle ne l’a vu qu’à de rares occasions et il guinche toujours avec la même cavalière. En plus une fille qui n’est pas du pays !
Parfois, quelques garçons tentent de la raccompagner chez elle, mais son père veille au grain. Vu la réputation du bonhomme, pas un des prétendants n’ose s’aventurer jusque dans la cour de la ferme.
– – –
Cet été 1895, les moissons sont terminées, le blé bien à l’abri dans les greniers. Le père de Jeanne a décidé de son destin. Il s’apprête à marier sa fille avec le fils d’un cultivateur voisin, Jules Péchaux, brave garçon offrant l’avantage d’être l’unique héritier de l’exploitation familiale. C’est donc par un mariage arrangé que Jeanne, à l’exemple de sa mère, épouse un homme qu’elle n’a pas choisi. Pour autant, elle s’est juré qu’il ne piétinera pas sa liberté de se comporter comme bon lui semble. Elle agira à sa guise, même sans le consentement de son mari. Elle a cependant accepté de travailler avec Jules chez ses beaux-parents.
Après une cérémonie célébrée sobrement, le couple emménage dans un logement du centre de Neuillé, héritage de son mari. Ce n’est pas bien grand, mais suffisant. La pièce principale est sombre, elle fait office de cuisine et de salle à manger et sent le feu de bois qui brûle dans la cuisinière, été comme hiver. Une soupe dans un fait‑tout bouillonnant mijote en permanence. Le doux fumet s’échappant du couvercle n’arrive toutefois pas à masquer l’odeur pénétrante du fourneau. Dans un recoin, un évier de pierre laisse couler l’eau directement dans le jardin. Lors des périodes de très grands froids, le médiocre chauffage ne suffit pas à faire grimper le mercure, car le couple économise le combustible. Bien souvent, il fait presque aussi glacial dans la pièce que dans les rues de Neuillé. Dans ce cas, pour la nuit, ils usent d’un palliatif. La bouilloire est toujours remplie et en attente sur le coin de la cuisinière. Jeanne emmaillote alors dans un linge une bouillotte en grès avec son bouchon de liège qu’elle dépose au fond du lit bien à l’endroit où elle se couche. De plus, chaque soir, Jeanne attrape la boîte de tilleul sur l’étagère en bois et se prépare une décoction qu’elle avale brûlante avant de se coucher.
Pour ce qui est de leur mobilier, il se limite au strict minimum. Une grande armoire fait office de garde‑manger. Une table, deux chaises et un vaisselier, héritage familial, complètent l’indispensable maie. Sur le côté, une porte donne sur une petite chambre éclairée seulement par une étroite lucarne. Placée assez haut, elle laisse entrer un mince rai de lumière ainsi qu’un peu d’air les rares fois où elle est ouverte.
Un débarras complète ces deux pièces du rez-de-chaussée. Le premier étage reste à l’abandon. À l’arrière de la maison, un vieux cabanon à demi effondré sert d’abri pour les outils de Jules qui cultive avec soin son potager.
Jeanne apprécie de travailler désormais dans la ferme de ses beaux‑parents. Bien sûr, la relation avec eux n’a rien de particulièrement chaleureux, mais au moins on ne lui crie pas dessus, comme son père n’avait cessé de le faire. Par ailleurs, elle s’entend mieux avec sa belle‑mère qu’avec sa propre mère. Elle la seconde pour la traite, la cuisine et l’entretien de la maison et ne participe jamais aux gros travaux. « C’est l’affaire des hommes » a‑t‑elle été prévenue. Cette nouvelle vie semble plus douce à Jeanne et puis Jules n’est pas très exigeant !
Neuillé‑sur‑Racan 1897
Cela fait maintenant deux ans qu’ils sont mariés. Le couple n’a toujours pas d’enfant. Un dimanche matin de janvier 1897, Jules annonce à sa femme qu’il doit aller aider son père pour de gros travaux qui ne peuvent attendre. Jeanne reste chez elle afin d’accomplir les tâches ménagères qu’elle n’a pas eu le temps d’effectuer dans la semaine. À midi, Jules ne rentre pas pour le déjeuner. Jeanne ne s’inquiète pas, elle s’imagine sans peine que, pris par leur besogne, les deux hommes n’ont pas trouvé un instant pour revenir manger. Sa belle‑mère leur a sûrement apporté de quoi se nourrir afin qu’ils ne perdent pas une minute.
La nuit vient de tomber, Jules n’est toujours pas de retour. Jeanne commence à s’impatienter : « Il va encore nous mettre en retard pour le souper », soupire‑t‑elle. Agacée, elle se couvre chaudement, sort de chez elle, enfourche sa bicyclette et se dirige vers la ferme de ses beaux‑parents. Surprise, elle trouve le couple attablé devant un grand bol de soupe :
— Jules n’est pas là ? lance‑t‑elle sans prendre la peine de les saluer.
Le père de son mari relève la tête, tandis que sa femme demeure silencieuse. Elle semble gênée.
— On ne l’a pas vu depuis hier soir.
— Il est pourtant venu travailler ici ce matin, s’insurge Jeanne.
La réponse de son beau‑père claque sèchement :
— Pas du tout.
Un silence glacial s’installe entre eux. « Où donc Jules peut‑il bien être ? s’interroge‑t‑elle. Pas au bistrot, il n’y va jamais ». Sa belle‑mère ose enfin s’adresser à son mari :
— Parle‑lui, toi.
— Qu’est-ce que vous devez m’apprendre ? s’emporte Jeanne.
— Lorsque Jules nous a quittés hier soir, il nous a demandé de ne pas nous inquiéter, car il allait partir quelque temps.
— Mais, il ne m’a rien dit, à moi, pourtant je suis sa femme.
Le père Péchaux, qui commence à s’agacer un peu, rétorque d’un ton sec :
— Écoute, il nous a indiqué t’avoir écrit une lettre qu’il a postée samedi matin. Tu l’auras lundi. Votre vie ne nous regarde pas.
Jeanne s’apprête à répliquer vertement, mais la mère de Jules s’en aperçoit et, connaissant son mari, s’en mêle avant que la discussion ne dégénère :
— Rentre chez toi et attends le courrier demain matin. Nous, on n’en sait pas plus.
Furieuse, Jeanne sort en claquant la porte et s’en retourne chez elle.
– – –
La nuit est longue pour Jeanne. Pas moyen de trouver le sommeil tant elle a de questions sans réponse. Le lendemain matin, elle ne se rend pas à la ferme de ses beaux‑parents, mais ne quitte pas son domicile de peur de rater le facteur. Lorsqu’enfin elle le voit glisser une enveloppe dans la boîte, elle se précipite pour la récupérer. La lettre entre les mains, elle hésite à l’ouvrir. Qu’est‑ce que Jules peut bien lui annoncer ? En dépliant la feuille, elle est déçue, car son mari n’a écrit que quelques lignes :
Jeanne,
J’ai bien réfléchi et, après ce qui s’est passé entre nous l’autre soir, j’ai décidé de partir. J’ai préparé mon affaire, je vais rejoindre l’armée. Mes parents ne sont pas au courant, alors ne t’en prends pas à eux. S’il m’arrive quelque chose, la maison sera à toi, j’ai fait ce qu’il faut chez le notaire.
Adieu,
Jules
Jeanne est sonnée. Elle plie la lettre, se couvre chaudement avant de sortir prendre son vélo dans la remise afin de se rendre chez ses beaux‑parents. « Ce n’est pas possible, ils doivent en savoir plus » ne peut‑elle s’empêcher de penser.
Elle trouve sa belle-mère en train de soigner les chèvres.
— Vous étiez au courant ? lance‑t‑elle en brandissant l’enveloppe reçue quelques instants plus tôt.
Surprise, la mère de Jules se retourne :
— Pas du tout, on te l’a dit hier soir, il nous a simplement annoncé qu’il allait partir rejoindre l’armée en Afrique. On ne sait rien de plus. Son père a cherché à comprendre pourquoi il faisait ça. Il est resté muet.
— Ce n’est pas possible.
— La seule chose qu’il a rajoutée, c’est de ne pas nous faire de la bile.
Jeanne n’insiste pas. Elle connaît sa belle‑mère et ne doute pas de sa sincérité.
Sans tarder, la nouvelle de la soudaine absence de Jules circule dans le bourg telles les feuilles que le vent d’automne emporte. Pourtant Jeanne n’en parle à personne de crainte d’avoir à fournir des explications qu’elle n’a pas. Ce départ provoque de nombreuses rumeurs dans le village, plus folles les unes que les autres. Mais personne ne réussit à obtenir la moindre clarification auprès de Jeanne, non plus que de ses parents, encore vivants à l’époque, mais qui depuis son mariage n’ont plus qu’une relation en dents de scie avec leur fille.
– – –
Plus de trois mois passent sans qu’aucune nouvelle ne vienne expliquer la séparation du couple Péchaux. Bien sûr, tout le monde sait que Jeanne n’a pas un caractère facile, mais de là à envisager une rupture si brutale ?
Jeanne ne veut plus être employée par ses beaux‑parents, aussi est‑elle retournée travailler dans la petite exploitation familiale de ses parents. Si ce retour ne semble pas déplaire à sa mère, il en va tout autrement avec son père qui ne lui adresse la parole que pour lui commander les tâches à exécuter. Pour lui, la séparation du couple est incompréhensible. Il ne se gêne pas pour le signifier à sa fille : « Tu n’as pas été foutue de garder ton bonhomme ! ».
Fin mai, lorsqu’un midi Jeanne rentre des champs, elle est surprise de trouver la voiture des gendarmes dans la cour de la ferme. Perplexe, elle pénètre dans la maison où elle remarque sa mère assise à la table, l’air absent. Debout, deux militaires accompagnent le maire de Neuillé. Quand il voit Jeanne pénétrer dans la pièce, le chef s’adresse à elle :
— Madame Péchaux, nous avons une bien triste nouvelle à vous apprendre.
Jeanne comprend aussitôt qu’elle ne peut que concerner Jules, mais ne montre aucun signe d’inquiétude. Le sous-officier continue :
— Votre mari, le soldat Jules Péchaux est mort au combat.
Le maire observe Jeanne qui ne bronche pas. Après quelques instants de silence, elle s’adresse au gendarme :
— Où ça ? souhaite‑t‑elle savoir, car elle n’a connaissance d’aucun conflit en France.
— À Say. Au Niger, croit‑il bon de préciser.
— Qu’est‑ce qu’il foutait là-bas ? interroge-t‑elle avec son habituelle sècheresse.
— Son régiment était allé rejoindre les troupes de l’Afrique-Occidentale française pour la prise de Say. C’est au cours des violents affrontements qu’il a été tué le 19 mai…
— Comment ça s’est passé ? l’interrompt Jeanne.
— Nous ne connaissons pas les circonstances exactes. Nous savons seulement qu’il est mort au combat.
Le maire, toujours silencieux, continue d’observer Jeanne. Pas la moindre larme n’est venue humidifier ses yeux. « Ce n’est pas possible, elle a un cœur de pierre », songe‑t‑il.
Le chef informe Jeanne que le corps de Jules va être rapatrié à Neuillé, ajoutant qu’elle pourra alors célébrer les obsèques. Il ne manque pas de préciser que cela ne se fera sûrement pas avant l’été. Le Niger est loin.
— Mes beaux‑parents sont au courant ? s’inquiète Jeanne.
— Pas encore, nous allons passer les voir en repartant de chez vous.
Jeanne et sa mère raccompagnent les gendarmes et le maire jusqu’à leur voiture. L’élu municipal semble très affecté par la disparition de Jules. Ancien maître d’école, il l’avait eu dans sa classe comme élève. Avant de refermer la portière, il s’adresse à Jeanne :
— Madame Péchaux, votre mari était un brave garçon. Je me demande ce qui lui a pris ?
N’y aurait‑il pas quelques reproches dans cette interrogation ?
De retour dans la cuisine, Jeanne retrouve sa mère qui n’a pas prononcé une parole depuis l’arrivée des gendarmes. Les deux femmes demeurent muettes puis, sans un mot, Jeanne sort de la pièce et enfourche son vélo appuyé contre le grillage du poulailler. À coups de pédales pleins de hargne, elle prend la direction de la ferme de ses beaux‑parents. Lorsqu’elle s’engage sur le chemin menant au bâtiment principal, elle croise la voiture de la gendarmerie. La mauvaise nouvelle vient de leur être annoncée. La porte d’entrée de la maisonnette en pierre est restée entrouverte. En pénétrant dans la maison, Jeanne découvre sa belle‑mère en pleurs :
— Ma pauvre fille ! gémit cette dernière, la gorge nouée en apercevant sa belle‑fille.
Jeanne ne trouve pas de réponse.
— Qu’est‑ce qu’il est allé faire là-bas ? Tu le sais, toi ? Il te l’a dit dans sa lettre ? laisse échapper la mère de Jules entre deux sanglots.
Jeanne assure que non. Tout se bouscule dans sa tête. Pour autant, les larmes ne parviennent pas à mouiller ses yeux.
Le père de Jules arrive pour le déjeuner. Sur son chemin, lorsqu’il croise les gendarmes, le pressentiment qu’un malheur vient de se produire lui serre la poitrine. Il fait presser le pas à son cheval et sans prendre la peine de le dételer, il s’empresse de rejoindre son logement. Quelques mots suffisent, son fils unique n’est plus. Il sort dans la cour en jurant pour cacher son émotion aux yeux des deux femmes.
– – –
Comme toujours, la nouvelle se répand comme un torrent en crue dans tout le village. Les interrogations sont encore plus nombreuses. L’armée, l’Afrique, qu’est‑ce qui a bien pu pousser Jules à faire ce choix ?
Jeanne se retrouve donc seule, sans enfant. Ses beaux-parents, très peinés par la disparition de leur fils unique, suggèrent à Jeanne de quitter la petite maison du bourg pour habiter avec eux à la ferme. La jeune veuve n’accepte pas, mais chaque semaine sa belle‑mère vient lui rendre visite les bras toujours chargés de provisions. Sa venue est fort appréciée en la circonstance.
L’été, comme prévu, le corps de Jules est rapatrié à Neuillé. Il est aussitôt enterré avec les honneurs militaires. Beaucoup de Neuillérois sont présents pour assister aux funérailles de cet enfant du pays. La cérémonie, bien que grave et solennelle, bruisse de médisances. Le brusque départ de Jules ne trouve toujours pas d’explication, alors les plus folles rumeurs circulent parmi les villageois. Les nombreux « Qu’il repose en paix » prononcés pendant les condoléances, font tressauter Jeanne à chaque fois. Elle y voit un reproche déguisé.
Depuis, pas une journée ne se passe sans que la mère du défunt ne dépose quelques fleurs sur sa tombe.
Peu de temps après les obsèques de Jules, on propose à Jeanne, au titre de veuve de guerre, un emploi dans l’administration qu’elle accepte. Elle devient la première et la seule factrice du canton.
En 1900 à Neuillé
Jeanne avait tout juste vingt‑quatre ans lorsqu’elle s’était retrouvée veuve, trois ans plus tôt. Pour autant, bien que belle et désirable, elle s’est juré de rayer pour toujours les hommes de sa vie. À ce moment‑là, Hector Meunier, de deux ans son aîné, est un très charmant garçon que toutes les filles du village convoitent. Grand, svelte avec de jolis cheveux bruns naturellement bouclés comme son père, il ne manque pas de prétendantes. Ses yeux clairs donnent une intensité, une profondeur à son regard qui trouble plus d’une belle du canton. La plupart du temps silencieux, Hector affiche calme, sérénité et sagesse. Même sa voix est posée, cela l’aide à masquer sa timidité. Il possède cette assurance qui confère une autorité naturelle. Lorsqu’il revient après ses obligations militaires, l’imagination de Jeanne s’envole. La résolution du passé est vite balayée. Elle prend sur elle pour faire quelques tentatives d’approche qui restent vaines. Alors elle s’enhardit jusqu’à provoquer une rencontre quand Hector passe devant chez elle pour aller chercher son paquet de tabac. Elle ose des paroles qui ne laissent pas de doute sur ses intentions. Hector demeure impassible. Pire, il repousse gentiment les avances de Jeanne en l’informant qu’il vient de s’éprendre de Victorine, une fille du village voisin. La désillusion est si grande que, dès cet instant, Jeanne commence à nourrir une rancœur tenace à l’encontre de celui qu’elle convoitait.
À partir de cette période, malgré de multiples sollicitations, Jeanne ne veut plus fréquenter les hommes, encore moins se remarier. Personne ne lui connaît la moindre liaison amoureuse.
– – –
À la fin de l’année 1900, la belle‑mère de Jeanne cesse, sans explication, de venir lui rendre visite. Pire, à la Toussaint, la tombe de Jules n’est pas fleurie par sa belle‑famille. Jeanne tente de les rencontrer, mais la porte de leur maison se ferme chaque fois qu’elle pénètre dans l’enceinte de la ferme. Pourtant, une fois, excédée par l’attitude de ses beaux‑parents, la jeune veuve reste plantée au beau milieu de la cour. La fenêtre de la cuisine s’ouvre enfin. Elle aperçoit son beau‑père derrière la mère de Jules. Il s’avance et, sans même un simple bonjour, annonce avec fermeté qu’ils ne veulent plus la voir. Décontenancée, Jeanne s’en va en se promettant de tenter d’approcher sa belle‑mère. Elle ne refusera pas de justifier cette nouvelle attitude.
Le dimanche suivant, lors d’une rencontre fortuite sur le parvis de l’église, l’explication entre les deux femmes est virulente. Jeanne n’arrive pas à saisir quels griefs la famille de son défunt mari semble avoir à son égard. Qu’est‑ce qui peut bien légitimer ce revirement ? Jeanne s’apprête à pénétrer dans le lieu saint lorsqu’elle se retourne et lance :
— Vous faites honte à votre fils, s’il vous voyait…
Sa belle‑mère remonte deux marches, l’interrompt en hurlant :
— Ne parle pas de Jules. Il est bien où il est… loin de toi !
Pour une fois, Jeanne reste sans voix.
Désireuses d’éviter d’en venir aux mains, les deux femmes se séparent, mais le triste spectacle n’a pas échappé à plusieurs témoins.
Dès qu’elle en a l’occasion, Jeanne rapporte la scène à Marceline. L’employée de mairie est la seule personne avec qui elle entretient une relation.
— Tu veux que je te dise, lui assure son amie, je remarque que depuis un moment lorsque je croise les parents de ce pauvre Jules ils n’ont plus vraiment l’air d’être chagrinés par sa disparition.
— Tu as raison, même que depuis quelque temps, ils ne déposent plus jamais la moindre fleur sur sa tombe.
— Non !
— Si. Ils sont radins, mais tout de même !
1915 – En Touraine
Depuis une année, la guerre fait rage avec, au printemps, la première utilisation de gaz incapacitants par les Allemands à Ypres.
À Neuillé‑sur‑Racan, la mère Péchaux, comme on la surnomme désormais, a en tout temps été au fait de tous les potins. Elle continue à livrer le courrier chaque jour. Comme ses collègues masculins, elle est rémunérée à la distance parcourue et à la journée. Sa tournée ne doit néanmoins pas dépasser trente-deux kilomètres. Heureusement, depuis le début du siècle, le vélo est l’allié indispensable du facteur. Jeanne refuse d’utiliser la charrette à chiens. Depuis cinq ans cette pratique est devenue courante dans la région. Elle se réjouira lorsqu’elle disparaîtra, en 1925, réprouvée par les associations protectrices des animaux. Elle s’achète une nouvelle bicyclette grâce à l’indemnisation qui lui est accordée pour amortit sa dépense.
Au début de son activité, Jeanne n’a pas été très bien accueillie lors de ses tournées. Une factrice, et en plus à vélo ! Beaucoup pensaient qu’elle ne tiendrait pas le coup, c’était mal connaître la jeune veuve.
Jeanne cherche souvent à connaître l’expéditeur des missives qu’elle distribue. S’il le faut, elle patiente jusqu’à ce que le bénéficiaire ouvre la lettre. Si besoin, elle ne manque pas d’interroger le destinataire quant au nom de ce dernier. Sa réputation a vite été faite, mais tous ont besoin d’elle. Peu de personnes osent lui faire des remontrances, car on la sait capable de représailles. Certains plis peuvent être remis en retard… voire égarés !
Dès les premières années de son veuvage, une vie de solitude l’attend. Au fur et à mesure des années qui passent, Jeanne devient jacasseuse et sans cœur. Elle est parmi les plus virulentes à l’encontre de Victorine et de son fils lorsqu’en décembre 1914, le malheur leur tombe sur la tête. Le bel Hector, celui‑là même qui a ignoré ses avances, est fusillé pour l’exemple au motif d’abandon de poste devant l’ennemi. Beaucoup dans le village ne veulent pas croire à la responsabilité du malheureux. Ils le connaissent, c’est un des leurs, un homme de cœur. Il n’a pas pu se dérober à son devoir. Jeanne, quant à elle, fait partie de ceux qui ne cessent de répandre « qu’il n’y a pas de fumée sans feu ! ». Elle fait même pression sur le curé pour qu’il refuse de dire une messe à sa mémoire. Victorine en est très peinée. Quant à Albert, l’unique enfant du couple Meunier, elle ne l’appelle pas autrement que « Le fils du fusillé ».
Jeanne n’a guère de visite. D’ailleurs, elle n’y tient pas. Seule Marceline, l’employée de mairie, vient en début d’après‑midi, chaque jour de la semaine, lui déposer le journal à son domicile. Par souci d’économie, elles l’achètent à deux. Enfin, Jean‑Marie Moreau, le curé, a lui le privilège d’être invité à sa table un dimanche par mois. Il est l’une des rares personnes à pénétrer et à passer quelques heures dans sa maison.
Après les moissons de 1920
La plus surprise est Jeanne Péchaux lorsqu’elle apprend que ses beaux‑parents ont quitté leur ferme. Respectivement âgés de soixante‑quinze et soixante‑treize ans, ils ont pourtant encore bon pied bon œil. Personne dans le village n’a eu vent de la mise en vente de leur petite exploitation agricole. Un jeune couple vient de faire l’acquisition des bâtiments, des terres et de tout le matériel. Quelques villageois ont bien eu un premier doute quand un matin ils ont vu partir les parents de Jules en tracteur avec une remorque pleine de meubles. Cependant, le lendemain, ils sont de retour et semblent avoir repris la vie d’avant. Comme les Péchaux ne sont pas très causants, personne ne parvient à connaître les raisons de ce déménagement.
Le dimanche suivant, à la grande surprise de Jeanne, sa belle‑mère n’assiste pas à l’office de onze heures. Ce n’est qu’à la sortie de l’église, après la messe, que les rumeurs commencent à circuler : les Péchaux ont quitté Neuillé pour de bon ! Même les mieux renseignés ne savent pas répondre à la question que tous se posent : « Pour aller où ? ». Peu s’aventurent à interroger Jeanne qui, de toute façon, serait bien en peine d’apporter le moindre éclaircissement.
Ce départ la tracasse, elle s’en confie à Marceline en espérant que celle‑ci pourra peut‑être glaner quelques informations du côté du maire. Mais rien ne filtre, ce qui ne fait qu’accentuer le trouble que cette nouvelle suscite chez Jeanne. Depuis plusieurs générations, les Péchaux sont des enfants du pays. Ont‑ils de la famille lointaine qu’ils sont allés rejoindre ? Toutes les questions demeurent sans réponse.
À la Toussaint suivante, Jeanne a la surprise de constater qu’une belle gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe de Jules. Ses parents sont‑ils passés au cimetière alors que depuis leur départ de Neuillé personne n’a eu de leurs nouvelles ? Décidément, le mystère reste entier.
Été 1937 en Touraine
Jeanne a désormais beaucoup de temps libre. À soixante-quatre ans, elle est depuis peu libérée de ses obligations professionnelles. Sa modeste pension lui permet de vivre au quotidien. Ses dépenses ne relèvent que du strict nécessaire. L’hiver, un peu d’épicerie vient compléter les conserves et autres confitures. L’été, les légumes de son jardin suffisent. Pour la viande, la basse‑cour fournit l’essentiel. Soucieuse de l’avenir, elle continue d’économiser avec la parcimonie d’un écureuil qui prépare l’hiver. Encore alerte, elle se déplace pourtant, en dehors de son logement, toujours avec sa canne, même pour se rendre à la boulangerie voisine. Elle n’en a nul besoin pour marcher, mais est prête à la brandir à la moindre remarque. Les gamins du bourg, Antoine en tête, le savent bien et s’en méfient.
Langue de vipère, Jeanne en a contre le monde entier. Personne ne trouve grâce à ses yeux, surtout les hommes, en particulier ce bougre d’Antoine Brainville qui ne manque jamais de lui faire un pied de nez ou autres grimaces chaque fois qu’il passe devant sa fenêtre.
Derrière ses rideaux, elle ne perd rien du spectacle offert chaque jour à sa vue. L’ancienne factrice est aux premières loges. Sa modeste habitation donne sur la place du village, face aux écoles ainsi qu’à la mairie et à proximité du parvis du lieu saint où les gens se rassemblent avant chaque célébration. Elle a comme proches voisins d’un côté la boulangerie, de l’autre l’épicerie‑mercerie‑tabac. À un moment ou à un autre, tous les villageois doivent passer devant chez elle pour faire leurs emplettes, se rendre à l’église ou encore effectuer une démarche à l’hôtel de ville.
Son unique compagnie est sa chienne Finaude. Bien malin qui peut dire de quelle race elle est. La plupart du temps, la bête, âgée d’une dizaine d’années et percluse de douleurs, est couchée aux pieds de sa maîtresse. Assurée de ne pas être contredite, c’est à elle que Jeanne se confie.
Elle se tient à sa place habituelle, aussi pas grand-chose ne peut échapper à la vigilance qu’elle exerce. Depuis qu’elle est à la retraite, elle laisse couler le temps, assise sur une chaise de paille derrière ses carreaux protégés par les petits rideaux en fils de coton tressés et noués.
Avec l’arrêt de son activité professionnelle, les journées de Jeanne sont parfaitement réglées. Tous les matins, elle assiste avec Marceline et une autre bigote, à la messe de sept heures. Avant la Grande Guerre, lorsque Jean‑Marie Moreau, tout jeune vicaire, est arrivé à Neuillé‑sur‑Racan pour seconder le curé dans les derniers jours de son sacerdoce, des rumeurs, vite propagées, voire amplifiées, ont circulé dans le village. Pour quelques vieilles fidèles, Jeanne passait beaucoup de temps auprès du nouveau prêtre. Pas de preuve, mais difficile d’empêcher les ragots de se répandre. À l’époque, cette soudaine piété avait intrigué quelques paroissiennes. D’autant que certaines affirmaient qu’elle n’avait même pas fait sa première communion !
Depuis le départ de son mari, il y a maintenant quarante ans, elle assure tous les samedis après-midi le ménage de l’église en vue de l’office dominical. Aujourd’hui, à la retraite, elle règne en maîtresse absolue sur le lieu de culte. C’est elle qui, tous les jours, fleurit le maître autel. Elle ne laisse à personne d’autre le soin de s’occuper des vêtements sacerdotaux. Jeanne lave même, et repasse, les habits personnels du curé. Vers quatorze heures, après le déjeuner qui est toujours suivi d’une brève sieste, elle retourne dans l’endroit saint pour procéder à son entretien. Elle y est chez elle et malheur à celles qui tentent de bousculer ses habitudes. Bon nombre de villageoises trouvent qu’elle y passe plus de temps que nécessaire. Pour autant, personne n’ose lui en faire la remarque.
Chaque matin, après son passage à l’église, elle effectue les indispensables courses alimentaires. Ensuite, elle se rend dans son jardin, pour quelques menus travaux, jusqu’à onze heures. C’est le moment où l’animation du village devient plus importante. Là, elle prend place sur sa chaise pour ne rien perdre des va‑et‑vient des passants devant sa fenêtre.
Peu coquette, elle est aujourd’hui une vieille dame au visage parcheminé par l’air et le soleil. Il ne faut guère s’approcher d’elle, ses gestes peu empreints de douceur sont vifs. Sa canne n’est jamais loin ! Sa voix puissante, même lorsqu’elle n’est pas en colère, va de pair avec un physique robuste. Ses cheveux sont en permanence bien coiffés en un strict chignon. Tous s’accordent à penser qu’elle a pourtant dû être un beau brin de femme dans sa jeunesse. Les villageois d’un âge avancé ne comprennent toujours pas pourquoi son mari a quitté brusquement le domicile conjugal pour aller risquer sa vie en Afrique.
—
En cette fin de matinée, un inconnu, que le train vient de déposer à la gare voisine, chemine à pied sur la route menant jusqu’à l’entrée du village. Sa tenue est des plus modeste, toute sa personne est à l’avenant. Sa figure respire une bonhomie souriante, rassurante. Il paraît heureux de vivre en progressant d’un pas leste. Le grand air qui fait s’envoler ses cheveux châtains qui ne semblent pas vouloir rester en place et rebiquent obstinément, les parfums de la campagne, l’aspect de la libre nature, tout semble faire sa joie, car pour lui une nouvelle aventure commence.
Lorsqu’il parvient à l’entrée du village, il fait une courte halte de quelques minutes. Il se retourne pour contempler la vue qui s’offre à lui. Des peupliers, des saules s’alignent sur les rives de l’Escotais, petite rivière qui serpente en prenant soin de contourner le centre bourg. Il fait beau, les oiseaux chantent, les blés frémissent. Les prairies sont vastes et riches en trèfle. De l’autre côté, des cultures, plus loin, quelques vergers voisinent avec des vignobles prometteurs. Toute cette perspective, verdoyante et fleurie, ruisselle de lumière. La rosée du matin n’est pas encore chassée par les premiers rayons du soleil. « La Touraine est belle, j’ai de la chance. », songe l’arrivant.
Il reprend sa marche, traverse le pont. De l’autre côté de la rivière, il s’aperçoit qu’à sa vue les lavandières cessent leur travail. Elles l’observent avec curiosité avant de se remettre à jacasser. Il se dirige alors vers ce qui semble être la grande rue du village. Un peu plus loin, c’est au tour du maréchal‑ferrant d’arrêter le soufflet de sa forge pour lui adresser un petit signe de bienvenue. « Les villageois se montrent accueillants », pense‑t‑il.
Ce matin-là, à son poste de prédilection, Jeanne Péchaux fredonne entre ses dents la chanson de Jean Sablon : « Vous, qui passez sans me voir. Sans même me dire bonsoir. », diffusée par sa vieille TSF.
Lorsqu’il parvient sur la place, Jeanne le voit arriver, une simple valise à la main. Elle soulève son rideau afin de mieux le détailler. Elle est certaine de ne l’avoir jamais ne serait‑ce qu’entrevu auparavant.
— Qui c’est donc ? lance-t‑elle sans obtenir de réponse de Finaude.
L’étranger, comme elle le surnomme immédiatement, a encore l’apparence d’un jeune homme et à son allure, la vieille femme en déduit qu’il doit être un gars de la terre.
Jeanne ne lui donne pas plus d’une vingtaine d’années. Il n’est ni grand ni petit, pas laid à regarder, mais « il n’a rien d’un séducteur » ne peut-elle s’empêcher de marmonner. Comme à regret, elle doit bien admettre que pourtant son aspect lui plaît. Une expression de franchise et d’honnêteté s’en dégage. La bonne humeur apparente se lit sur sa figure, le rendant d’emblée sympathique. Sur son front un peu découvert, on devine l’intelligence, dans ses yeux vifs, mais pleins de douceur, la tendresse et la volonté. Malgré cela, la mère Péchaux l’observe avec méfiance, c’est un étranger !
Planté là, au beau milieu de la place, le jeune homme semble hésiter. Il scrute tour à tour les bâtiments qui l’entourent. Puis il se décide et prend la direction de la mairie.
Lorsque Jeanne le voit pénétrer dans la maison commune, elle sait qu’elle ne tardera pas à connaître son identité et les raisons de sa présence dans le bourg. En effet, Marceline, l’employée municipale, est aussi cancanière qu’elle. À midi, en se rendant, comme chaque jour, à la boulangerie, elle s’arrêtera chez elle pour lui redonner le journal.
Ainsi l’arrivée d’Émile à Neuillé‑sur‑Racan ne passe pas inaperçue…