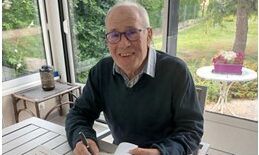Amour de guerre
Au domaine de la Grande Borde, ce dernier dimanche du mois d’août 1913, l’on était en fête. À La Ferrière, village paisible de Touraine, on s’apprêtait à célébrer les fiançailles de la fille des Saint‑Valert avec Louis, le fils unique des Monteron.
La vaste propriété agricole des Saint‑Valert était située un peu à l’écart du bourg. La grande allée, qui conduisait au cœur du domaine, était bordée d’ormes champêtres centenaires aux écorces fissurées d’un brun noirâtre. En laissant sur la droite un petit étang, le visiteur se retrouvait face à une authentique et imposante demeure du XVIIIe siècle. Un large perron, encadré d’une balustrade, menait à l’entrée principale.
La famille Saint‑Valert n’utilisait qu’une partie de l’habitation. Une aile, qui leur avait servi de logement après leur mariage, restait inoccupée.
Un peu à l’écart, près d’une petite fosse, une maison de gardien, habitée par le régisseur. Un grand jardin fruitier la séparait des dépendances couvertes de tuiles, où étaient conservés les fourrages et les grains. À côté, un hangar abritait le matériel agricole et jouxtait les écuries creusées dans le tuffeau. Non loin de là, un tas de fumier parfaitement tenu. On ne risquait pas de rencontrer une volaille ou un chien, la propriétaire s’y était opposée. Seuls quelques chats, venus d’on ne savait où osaient parfois s’aventurer dans la cour pour rejoindre les greniers.
Derrière la belle demeure, dans le magnifique parc de la propriété, de petites allées faisaient découvrir des chênes centenaires qui ombrageaient le sol de leurs rameaux verdoyants.
Ce domaine appartenait à la famille depuis plusieurs générations. Marie y avait vécu une enfance heureuse. Fille et petite‑fille unique, elle avait été choyée par ses parents et grands‑parents paternels. Depuis le décès de ces derniers, Georges et Amélise de Saint‑Valert étaient les seuls héritiers du patrimoine familial composé de plusieurs métairies qui leur assuraient de confortables revenus.
Georges de Saint‑Valert avait passé la quarantaine lorsqu’il avait épousé Amélise qui, de son côté, venait de fêter ses trente ans. Si elle ne s’était pas mariée plus tôt, c’est qu’elle n’était pas d’une beauté renversante, sa dot avait compensé ! Maigre, volontaire, souvent mécontente, Amélise n’arrivait pas à vaincre la bonne humeur perpétuelle qui caractérisait son mari. Dès le début de leur union, Amélise avait décrété que la nature ne l’avait pas faite pour être mère. Georges avait alors espéré que leur unique enfant serait un garçon. Hélas, ce fut Marie qui vint au monde.
—
Marie était devenue une belle jeune femme de 24 ans. Un visage finement modelé, harmonieux, ovale et mince, avec des pommettes roses. Une épaisse frange brune lui cachait une partie du front. Plutôt de petite taille, elle avait un regard impétueux et direct. Badine, elle ne manquait pas d’humour, et son charisme était tel qu’elle ne passait pas inaperçue. D’une nature franche et libre, dès l’adolescence, son caractère bien trempé avait été source d’échanges, parfois vifs, avec sa mère. Quant à son père, il avait du mal à cacher son admiration pour elle. En plus d’une bonne éducation, Marie avait appris à monter à cheval, à dessiner et même à danser, mais ce qu’elle aimait par dessus tout était la lecture. Le tourangeau Honoré de Balzac avait sa préférence.
Après une brillante scolarité dans un internat de Tours, elle avait opté pour des études sanitaires enseignées par la Société de la Croix‑Rouge du chef‑lieu du département. Elle venait de réussir ses examens d’une manière émérite.
—
Louis de Monteron, le futur fiancé, habitait Saint‑Paterne, bourgade distante d’une petite dizaine de kilomètres de La Ferrière. Ses parents étaient eux aussi propriétaires d’un important domaine agricole. Le jeune homme, âgé de vingt‑cinq ans, avait acquis une certaine élégance. De taille moyenne, son allure et sa distinction naturelle séduisaient au premier abord. Débarrassé depuis un an de ses obligations militaires, sa destinée était toute tracée, il prendrait la succession de Jean, son père. Les deux familles se connaissaient et se fréquentaient depuis de nombreuses années. Chaque fin de semaine, après avoir assisté à la messe dans leurs villages respectifs, ils aimaient se retrouver pour le reste de la journée. Le déjeuner, tantôt à La Ferrière, tantôt à Saint‑Paterne, était suivi d’une courte promenade à pied avant la traditionnelle rencontre de bridge. Dès leur plus jeune âge, Marie et Louis avaient passé leurs après‑midis du dimanche en compagnie l’un de l’autre. Ils les avaient souvent trouvés longs. Par la force des choses, une complicité était née entre eux sous le regard bienveillant de leurs parents. Après les jeux d’enfants, vinrent à l’adolescence les confidences réciproques. Une connivence tacite les rapprocha. Louis tenta alors quelques gestes plus intimes, très vite réprimandé par la belle. Il mit cette attitude sur le compte de son éducation. À l’approche de leur vingtième année, leur entourage n’avait de cesse de répéter qu’ils étaient faits l’un pour l’autre ! Ce qui, à l’inverse de Marie, plaisait à Louis.
Avec le plus grand sérieux, les parents de la jeune fille, sans prendre son avis, envisagèrent les fiançailles. Pour son père, Louis était fréquentable, bien portant et de bonne famille. « C’est l’essentiel ! » n’avait pas manqué de soutenir sa mère. Devant de telles évidences, Marie avait fini par céder à la pression familiale, bien qu’elle n’éprouvât guère de sentiment amoureux pour son futur fiancé. Elle prit tout cela pour un jeu. Pour se convaincre, elle avait admis qu’il n’était pas désagréable à regarder et qu’il était gentil ! Elle espérait que le temps ferait son œuvre.
—
Quelques semaines avant les fiançailles, Jean, le père de Louis, comme il était de tradition, avait fait la demande officielle auprès des parents de la jeune fille. Ce jour‑là, il était venu seul à la Grande Borde. Pour l’occasion, la relation intime entre les familles avait disparu, laissant place à une mise en scène théâtrale qui n’aurait pas été du goût de Marie. Après les premiers mots de bienvenue, Jean fit connaître l’objet de sa démarche. Georges et Amélise répondirent par l’affirmative et remercièrent de l’honneur qui leur était fait. Georges pria alors Marie de se joindre à eux trois. Il lui transmit la demande du père de Louis qu’elle accepta avec un enthousiasme mesuré. Jean de Monteron demanda la permission de retourner dans sa voiture hippomobile et en revint avec une gerbe blanche qu’il offrit à Marie. Ce présent n’avait qu’une valeur de symbole. L’engagement qu’il représentait n’était pas ratifié par la loi ni par la religion, mais il était pourtant grave et ne pouvait être rompu à la légère. Pour conclure sa démarche solennelle, Jean se tourna vers Georges et Amélise et sollicita pour son fils le droit de se présenter comme fiancé officiel, ce qui lui fut accordé. La date de fiançailles fut fixée, ce serait le dernier dimanche d’août. Ce qu’ignorait Marie, c’est que les deux familles avaient tout organisé avant. Ils s’étaient pliés à ce simulacre de protocole par convenance.
—
Le jour venu, le cérémonial débuta par une messe célébrée dans l’église de La Ferrière. À cette occasion, pendant l’office, tous les participants purent apercevoir la bague posée sur un petit plateau. Après la communion, le prêtre qui officiait l’avait bénie. À l’issue de la cérémonie religieuse, les deux familles ainsi que quelques proches se retrouvèrent à la Grande Borde pour le repas de fiançailles. De retour au domaine, avant de se mettre à table, Louis offrit un bel écrin blanc à Marie. Le matin même à l’église, comme les autres invités, elle n’avait qu’entraperçu le joyau. C’était un magnifique bijou, hérité d’une des grands‑mères de son fiancé, mais qu’elle n’avait pas choisi. Le baguier ouvert, la merveille fut présentée à tous les convives qui s’extasièrent sur la beauté du précieux objet, avant que Louis le lui glisse au doigt. La cérémonie officielle terminée, l’on pouvait maintenant passer à la salle à manger pour un repas qu’Amélise avait concocté avec la cuisinière. L’employée, embauchée par les parents de Georges, régnait sans partage dans une cuisine aux carreaux en faïence bleue et blanche. Bien qu’âgée, elle assurait sa tâche sans défaillir. « Je n’quitt’rai ma popote que les pieds d’vant ! » avait‑elle, un jour, déclaré à Amélise. Depuis peu, contre sa volonté, les Saint‑Valert avaient fait l’acquisition d’un fourneau en fonte noire qui, encastrée dans l’ancienne cheminée, rayonnait de tous ses cuivres. Tout juste si Amélise avait le droit d’accéder aux placards en bois mouluré, ou ceux vitrés où s’empilait la vaisselle. Les hautes fenêtres faisaient de cette pièce la plus claire du rez‑de‑chaussée. Tous les invités se retrouvèrent donc dans la salle à manger. C’était Amélise qui s’était chargée de l’ameublement de la pièce. Elle avait cédé au style Belle Époque. Une immense table en églantier, aux pieds arrondis en forme de branche, occupait une grande partie de la pièce. Pas moins d’une douzaine de chaises l’entourait. Ces sièges, aux dossiers étroits et hauts, avaient une ornementation très recherchée et raffinée, mais étaient toutes plus raides et inconfortables les unes que les autres. Cette salle à manger était sans gaieté. Peu de meubles, juste un vaisselier et dans un coin, une sellette à plateaux pour les plantes vertes. À part y prendre les repas, la pièce ne donnait guère envie d’y séjourner longtemps. Amélise l’avait voulue à son image, c’était réussi ! Pour cette journée exceptionnelle, la maîtresse de maison avait préparé un plan de table savamment étudié. Marie se retrouva entre son fiancé et son père. La présence de ce dernier à ses côtés la rassurait, car la jeune fille avait la curieuse sensation d’être étrangère à cette fête. Amélise annonça le menu : après le consommé et les paupiettes de soles, vinrent comme relevé des noisettes de Pré‑salé Rossini. Les convives pouvaient maintenant s’attaquer à la Poularde de Bresse et ses haricots. La fiancée commençait à trouver le repas un peu long. Pourtant il n’était pas terminé, le rôt arrivait avec une bécasse flambée et sa salade, le tout accompagné d’écrevisses en buisson. Pour Marie, c’était trop, mais comment ne pas faire honneur au menu de sa mère sans la froisser ? Les discussions tournaient autour de l’actualité du moment. La durée du service militaire venait d’être portée à trois ans. Les hommes s’interrogeaient : était‑ce pour faire suite aux incidents franco‑allemands du mois d’avril en Lorraine ? Ces discussions permirent une petite pause avant l’arrivée des entremets et des desserts. D’habitude, Jean avait un principe auquel il ne dérogeait jamais : l’hiver, il partait à seize heures et l’été une heure plus tard. Cette fois‑ci, il ne s’en souciait guère, car l’heure prévue était largement dépassée. De son côté, Louis attendait avec impatience la fin du repas pour se retrouver seul avec celle qui était désormais sa fiancée. Il n’en fut rien. À dix‑huit heures, les hommes passèrent au salon pour des liqueurs. Quant aux femmes, elles s’installèrent près de la vieille table à jouer en marqueterie dont le dessus pouvait aussi servir d’échiquier et qui avait été recouverte d’un épais tissu afin de poursuivre leur conversation. Devant la fenêtre, Amélise prit place sur le fauteuil réservé à la belle saison. L’hiver, c’était celui devant la cheminée qui avait sa préférence. Sur le mur, au-dessus de l’âtre, deux portraits en pastel représentaient les grands‑parents de Georges. Elle n’avait jamais osé y toucher, son mari ne l’aurait pas toléré. Au grand dam de Louis, Marie s’était jointe à elles et ne semblait pas vouloir les quitter. À dix‑neuf heures, Jean de Monteron se leva et demanda à Georges de faire préparer sa voiture. Pantois, Louis avait imaginé autrement ses fiançailles. Il avait espéré un rapprochement plus intime, car il devait admettre que sa fiancée était restée plutôt distante tout au long de la journée. Petit à petit, les invités quittèrent le domaine, laissant les familles entre elles pour la séparation qui ne tarda guère. Au moment du départ, Amélise ne put s’empêcher d’annoncer qu’un an plus tard, un mariage serait célébré ! Ce qui sembla ravir Louis. Georges demeura silencieux et observa la réaction de sa fille du coin de l’œil. « On a le temps ! » se contenta de répondre Marie. Après une longue réflexion et de nombreuses interrogations, elle laissa publier les bans.
—
L’année passa. Marie ne montra guère plus d’élan amoureux envers celui qui deviendrait son conjoint. Louis avait tenté quelques manœuvres audacieuses de rapprochement, mais sans succès. Par une sorte de pudeur effarouchée, Marie trouvait toujours un prétexte pour refuser les chastes caresses. Elle lui répétait, comme une rengaine, qu’ils n’étaient pas mariés ! Le jeune homme n’insistait pas, car sa belle avait du caractère, alors, il prit patience…
—————
Cet été de 1914 aurait pu paraître encore plus beau que d’habitude. Cependant, depuis plusieurs mois, un mauvais pressentiment avait gagné les hommes qui, pour l’instant, étaient en pleine moisson. La principale préoccupation était de mettre les sacs de grains à l’abri dans les greniers. La récolte avait été bonne. Malgré cela, en ce début d’août, les visages étaient soucieux. Fin juillet, les armées françaises avaient convergé vers la Meuse et Jean Jaurès venait d’être assassiné. Quelques optimistes disaient que cela n’avait pas d’importance, ce serait comme les autres fois, mais pour beaucoup, l’espoir avait disparu.
—
À la grande Borde, le mariage avait été reporté. Le père et la mère de Marie s’inquiétaient pour leur futur gendre. Comme la majorité des hommes, il devait partir pour le front. En effet le samedi premier août vers les cinq heures du soir, à La Ferrière ainsi qu’à Saint‑Paterne, de grandes affiches avaient été collées dans le canton, jusque sur les murs des granges. La guerre contre l’Allemagne était déclarée. À part les plus anciens et quelques rares exemptés, tous les hommes devaient se mettre en route. Certains étaient enthousiastes, joyeux et confiants. Ils se rassuraient en pensant qu’ils ne seraient pas absents longtemps ! Pour sa part, monsieur de Saint‑Valert en doutait. Les mobilisés ne songeaient pas à reprendre l’Alsace‑Lorraine, mais ils étaient résolus à défendre le pays contre l’envahisseur qui avait déclenché la guerre.
—
Marie se sentait concernée par les événements, car, à la fin de ses études, comme de nombreuses autres élèves, elle avait pris l’engagement auprès de la Croix‑Rouge de servir en temps de guerre. Louis parti pour le front, Marie avait donc décidé de rejoindre le siège social de la Croix‑Rouge à Tours. Lorsqu’elle annonça sa décision à ses parents, la discussion fut animée. Ceux‑ci lui assurèrent qu’elle n’avait aucune obligation envers l’organisation humanitaire. Son fiancé faisait son devoir pour eux deux. Rien n’y fit. La jeune fille, portée par un patriotisme sincère et par l’atmosphère ambiante, était déterminée. Elle voulait porter secours aux blessés. Georges de Saint‑Valert tenta un argument qu’il crut susceptible de faire renoncer sa fille :
— Ton fiancé n’aurait pas été d’accord.
— Je m’en fiche, rétorqua Marie. C’était la première fois qu’elle s’adressait de la sorte à son père. Amélise, sa mère, se tourna vers son mari :
— Vous ne répondez pas ? C’est vrai que vous cédez tout à votre fille chérie, conclut‑elle en tournant les talons.
—
Volontaire, Marie avait déjà préparé ses affaires. Georges connaissait par avance l’entêtement de sa fille ; aussi, le jour prévu, avait‑il fait atteler le cheval à la carriole pour la conduire jusqu’à la gare de La Ferrière. La séparation fut pénible. Sa mère était en larmes, son père parvenait difficilement à retenir les siennes.
— Fais attention à toi, ne sut‑il que conseiller avant que Marie prenne place dans le wagon.
—
Dès son arrivée à Tours, Marie constata que le siège social de la Croix‑Rouge était envahi. Il y avait foule. Elle attendit patiemment son tour. De nombreuses femmes, de tous âges, venaient offrir leur aide. Certaines, sans aucune expérience, n’avaient à proposer que leurs bras. Son professionnalisme reconnu, Marie fut dirigée vers l’hôpital général du centre‑ville qu’elle s’empressa de rejoindre. Les premières journées furent pénibles. Le service de santé des armées s’était trouvé vite dépassé par le nombre de blessés et la gravité de leurs blessures. Avec un tel flux de volontaires, tout était à organiser. La majorité des femmes voulaient être infirmières même si beaucoup ne supportaient pas la vue du sang. Les soignantes religieuses faisaient cruellement défaut depuis qu’en 1905 on les avait éloignées des hôpitaux publics. Désormais, elles n’exerçaient plus que dans les établissements de leur confession. Les auxiliaires affectées aux évacuations étaient pour la plupart des débutantes. Elles avaient suivi les cours de la Croix‑Rouge, mais avaient surtout appris sur le tas. Beaucoup étaient des jeunes filles de bonne famille et devaient se plier à la même discipline que dans les hôpitaux. Le visage de certaines était aussi blanc que leur blouse.
————-
Pierre Fernand appartenait à la classe 1914. Pour éviter la pénurie de combattants, toute cette jeunesse fut rapidement appelée par anticipation, deux mois avant la date prévue. C’est ainsi que le jeune homme se retrouva sous les drapeaux le 1er septembre. Pour cette génération sacrifiée, il n’y eut pas de départ, musique en tête, suivi de la foule comme pour les autres mobilisés quelques semaines plus tôt. Dès son arrivée, Pierre fut en proie aux mêmes difficultés que lors du conseil de révision. Pour le sous‑officier chargé de son instruction, son nom de famille était Fernand, pour ses camarades de chambrée, il n’avait que deux prénoms ! Les uns l’appelaient Pierre, les autres Fernand, sans comprendre cette singularité. À leur décharge, Pierre ne faisait rien pour éclaircir cette ambiguïté. À ceux qui l’interrogeaient, il répondait invariablement qu’il avait deux prénoms. Son caractère gai et enjoué le faisait accepter par tous. D’un naturel optimiste, il était confiant en l’avenir, ce qui rassurait ceux de ses camarades qui broyaient du noir. Lorsqu’il avait déclaré qu’il était employé de ferme, beaucoup en avaient douté. Il n’avait pas les manières d’un paysan. Son allure, sa façon de s’exprimer ne concordaient pas avec l’attitude d’un travailleur de la terre. Pourtant, il était bien un ouvrier agricole !
—
Au même titre que ses camarades, il fit ses classes de manière accélérée. Au maniement des armes succédaient les nombreuses corvées. Épousseter les couvertures était l’un des jeux favoris de leur sergent. Avec son bourgeron et son pantalon de treillis, Pierre ne rechignait jamais à la tâche. Il trouvait le travail moins pénible qu’à la ferme.
Puis vint le temps des premières manœuvres avec leurs interminables marches.
La formation fut brève. Avec ses camarades, Pierre fut envoyé ensuite dans un régiment d’infanterie chargé de former les nouvelles recrues à proximité du front. Après quelques semaines, il rejoignit une unité aux alentours de Verdun.
Pendant le trajet qui le conduisait vers l’Est, Pierre fut surpris par les encouragements de la population. Partout, femmes et enfants les acclamaient et leur lançaient des « au revoir » sur leur passage aux cris de « À Berlin ! ».
On s’encourageait entre civils et militaires, mais la réalité était cette peur de tout perdre, cette angoisse qui le gagnait au fur et à mesure qu’ils approchaient du front…
livres, romans historiques, romans terroir, roman historique poche, livre roman, littérature française régionale, histoire et actualité des pays, romance et littérature sentimentale